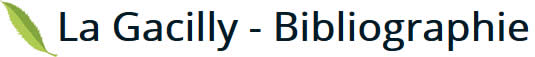Symboles utilisés
o : naissance, x : mariage (x : 1er mariage, xx : 2ème mariage... , + : décès, ca : environ, ? : date évaluée
exemple : (oca1584) signifie "naissance en 1584 environ"
- Paul Hercule (o?)
- Anne Hélène (o?)
- Louise (o?)
Enfants H René Louis de RIEUX de SOURDEAC F Louise de RIEUX - de SOURDEAC F Anne Hélène de RIEUX de SOURDEAC H Paul Hercule de RIEUX de SOURDEAC Alexandre de Rieux était un triste original. Tallemand des Réaux a dit de lui : « II se fait courir par ses paysans comme on court un cerf et dit que c'est pour faire exercice ». II n'y a pas meilleur serrurier au monde, ajoute Tallemand, il travaille de la main admirablement. II travaillait si bien que, de serrurier et de mécanicien, il devint machiniste et entrepreneur de spectacles. Il fit construire, dans son hôtel à Paris, une salle de spectacle où il représentait gratis les œuvres de Corneille. En 1660, il commande à Pierre Corneille une pièce, La Toison d'or, pour célébrer le mariage de Louis XIV. Présentée d'abord à son château de Neufbourg (voir ci-après) avec la participation des comédiens du Marais, la pièce est transférée au Marais en 1661 avec toutes les machines et les décorations. Le 16 avril 1661, il est parrain de Charlotte Lenoir, qui deviendra, en 1675, femme de Michel Baron et, en 1695, la belle-mère de Catherine Vondrebeck. Le 12 décembre 1669, le marquis de Sourdéac, l’abbé Perrin et le financier Champeron louent le Jeu de Paume de Bécquet et dépensent des sommes considérables en y construisant une salle d'opéra inutilement, car ils en seront expulsés par le lieutenant de police. Leurs peines n'y sont pas pour rien : en 1672, la salle servira à Lully et , en 1710, sous la direction des entrepreneurs forains, elle deviendra la première salle qui porte le nom de l'Opéra-Comique Le 8 octobre1670, il signe un bail pour la location du Jeu de Paume de la Bouteille qui deviendra la première salle de l'Opéra à Paris. En mars 1671, il crée les machines pour la pastorale de Pomone en cinq actes, au Jeu de Paume de la Bouteille, la première représentation publique de l'Académie d'Opéra. Le texte est de l’abbé Perrin, la musique de Cambert, le marquis avait fait les machines et Saint-Evremond qui fut un des spectateurs, ajoute malicieusement : « Pomone est le premier opéra français qui ait paru sur notre théâtre ; M. de Sourdéac en fait les machines : c'est assez dire pour vous donner une grande idée de leur beauté. On voyait les machines avec surprise, les danses avec plaisir » . C'est ainsi que le chef de la branche de Sourdéac se ruinait noblement ou plutôt artistiquement. Le 30 mai 1672, dépourvus du privilège de l'Opéra par Lully, Sourdéac et Champeron font appel au Parlement de Paris, mais sans effet. Le 23 mai 1673, la troupe de Molière, mort le 17 février, s'unissant à celle du Marais sous le nom des Comédiens du roi, loue le Jeu de Paume de la Bouteille de Sourdéac et de Champeron quand l'ancienne salle de Molière, au Palais-Royal, passe à Lully. La troupe achète "le théâtre, orchestre, machines, mouvements, cordages, contre poids, peintures.", et les deux vendeurs deviennent membres de la troupe avec droit de voter aux délibérations. Le 17 mars 1675, Circé emploie des sauteurs et des machines volantes. "Les machines sont de l'invention du Marquis de Sourdéac qui est incomparable en cela, " écrit Bayle. [9] Mars 1675 : La Grille obtient un privilège pour la Troupe royale des Pygmées. Sourdéac s'y intéresse aussi, peut-être ? En 1676, Le Théâtre de la Foire à Paris Les Pygmées,[10] premier spectacle de La Troupe royale des Pygmées, paraît au Marais. C'est un opéra de marionnettes " des figures humaines de quatre pieds de haut, richement habillées, en très grand nombre qui vont réciter, marcher, actionner comme des personnes vivantes... sans qu'on les tienne suspendues ." Le privilège, pour la troupe, fut accordé à La Grille, chanteur de la Musique de la Chambre du roi, en mars 1675. Les chansons rappellent celles de Pierre Perrin, fondateur de l'Académie d'Opéra en 1669. Les machines volantes et les décors rappellent l'œuvre du marquis de Sourdéac qui, avec La Grille, participait à l'entreprise de Perrin jusqu'au moment où Lully leur enleva le privilège de l'Opéra. Le thème des Pygmées rappelle le ballet dansé à Essaune, en 1656, pour la réception de la reine Christine de Suède dont Beauchamp, maître de ballet pour Perrin et ensuite pour Lully, a fait la chorégraphie. Perrin lui-même emploie l'image des Pygmées dans son ballet des faux Roys : la quatrième entrée de la IIe partie présente : « ... un petit garçon déguisé en nain, avec un bouclier et une grande épée, qui semble combattre contre les grues qui volent en l'air »] Dès 1692, le Parlement avait décrété la vente des biens de Alexandre de Rieux dit Sourdéac, principalement Landivisiau, Neufbourg en Normandie, Kermelin, Coëtmur, l'lle-d'Ouessant, le Bourg-l'Evéque, etc. Les archives de la Comédie française conservent un volumineux dossier relatif à ces longs procès, et ce dossier se trouve considérablement accru par des pièces de procédure entièrement personnelles au marquis de Sourdéac , des oppositions, des arrêts lui étaient signifiés chez les comédiens ; on y opérait même des saisies contre lesquelles ils furent parfois obligés de se défendre. On sait de reste qu’il ne payait que contraint et forcé, et quand ses créanciers avaient plaidé devant toutes les juridictions, et usé du papier timbré sous toutes ses formes. Ces grimoires de procureurs et d’huissiers n’ont aucun rapport avec l’histoire de l’Opéra. Mais parmi ces pièces de procédure ayant trait presque toujours à des poursuites de créanciers, il en est qui appartiennent à un procès que son fils, le chevalier René de Sourdéac, eut à soutenir contre lui en 1688. Ce n’était pas le premier, car lors du mariage de ce fils en 1682, son père avait élevé contre cette union des contestations qui ne cessèrent qu’en vertu d’un arrêt de la Tournelle. En cherchant bien, on trouverait aussi sans doute quelques mémoires relatifs au procès de Sourdéac avec sa malheureuse femme, qui finit par obtenir la séparation judiciaire. Le désordre en tout et la manière de comprendre les affaires du seigneur de Neufbourg étaient bien faits pour déranger la plus grande et la plus solide fortune. Les désastres arrivèrent donc, et les embarras contre lesquels il avait à se débattre finirent par devenir inextricables. Un mémoire de la marquise explique que dès 1687 ou 1688, tous les biens de son prodigue époux étaient sous séquestre, qu’il avait des curateurs judiciaires et que ceux-ci “ayant les mains pleines“, étaient accusés de chercher à éterniser les débats. La chose ne leur était que trop facile, vu le grand nombre de créanciers à satisfaire, la multiplicité des opérations de toute nature à démêler, et la quantité des procès à soutenir ; le gaspillage continua donc après comme avant. Madame de Sourdéac qui était intervenue dans cette liquidation si embrouillée, pour sauver sa dot et un douaire assez considérables, demandait qu’il fut versé 12000 livres par provision et démontrait qu’il était possible de les lui donner d’après les revenus des terres de Neufbourg, de landivisiau, de Sourdéac, de Bourg-Lévesque, de l’île d’Ouessant, y compris la valeur de l’hôtel de la rue Garancière. Le mémoire ajoute : “Au temps que la dame de Sourdéac n’estoit pas séparée, qu’elle n’avoit de pain quasi que par grâce, et que toutes ses prétentions vraies ou fausses, nouvelle ou anciennes contre le sieur de Sourdéac luy faisait obstacle, la Cour lui a toujours donné six mille livres par an jusques et y compris le 6 septembre 1686… Elle n’a aucune terre ni maison de campagne où elle puisse aller faire quelque épargne… en un mot, elle est sans pain.“ La branche Sourdéac de la maison de Rieux fut complètement ruinée. . Fin de la Famille de Rieux L'histoire de la maison de Rieux a duré autant que l'histoire de Bretagne elle-même. Et l'on y trouve des grands hommes à chaque génération. Tant qu'ils ont vécu et combattu sur le sol de la patrie bretonne, la sève vigoureuse de cette illustre race n'a rien perdu de sa fécondité Mais, hélas, il semble qu'il lui fallait la terre natale pour conserver sa vigueur. En effet, après la réunion de la Bretagne à la France et surtout lorsque, sous Louis XIII et Louis XIV, ils devinrent seigneurs de la cour, au lieu d'être presque des princes en Bretagne, la décadence commença ; les alliances sont dès lors moins brillantes et l'on voit poindre la gène, les emprunts, les saisies de ces admirables terres, véritables principautés où ils régnaient, traitant presque d'égal à égal avec leurs souverains et enfin les ventes et la ruine. A partir de cette absorption par la France, ils doivent se contenter de vivre en simples seigneurs et ils deviennent, comme tout le monde, colonels de quelque régiment : on les voit se ruiner, comme le marquis de Sourdéac à fonder l'Opéra. Chaque branche s'éteint à son tour, jusqu'à ce qu'enfin le dernier du nom vint mourir tragiquement dans les marais d'Auray, (voir ci-dessous) comme si la terre bretonne eut été jalouse de recevoir et d'absorber les dernières gouttes de ce sang illustre qui, à la fin de sa grande race, lui revenait comme au sein de sa mère. Le château de Rieux fut démoli ; déjà celui de Sourdéac était à peu près en ruines ; la Forêt-Neuve ne valait guère-mieux. Le duc de Lorraine vendit les terres du comté de Rieux, en 1662, à messire Louis François Cyr de Rieux dernier marquis de Sourdéac et dernier comte de Rieux, mourut en Angleterre, son fils unique, Louis, le dernier descendant des Rieux, pris à Quiberon, périt fusillé au champ des Martyrs en 1795