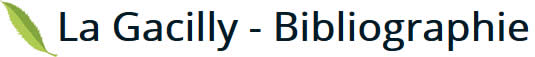Symboles utilisés
o : naissance, x : mariage (x : 1er mariage, xx : 2ème mariage... , + : décès, ca : environ, ? : date évaluée
exemple : (oca1584) signifie "naissance en 1584 environ"
- Jeanne.1 (o?)
- Roland (o?)
- Guillaume.2 (o?)
Renaud de MONTAUBAN, chevalier, seigneur du Binio, du Couédor, du Maz, d'Irodouër, du Bois-de-la-Roche, du Bois-d'Anast, du Boisbasset, de Vauvert, de Launay. Second fils d'Olivier II de MONTAUBAN et de Louise de la Soraye (ou, d'après le P. du Paz et l'abbé Le Claire), fils de Alain de MONTAUBAN et de Mathilde de Montfort). Il fut tuteur en 1340 de son .neveu, Olivier IV de MONTAUBAN, et passa un acte d'accord à ce sujet avec Julienne de Tournemine, sa belle-sœur, veuve d'Olivier III de MONTAUBAN. Il épousa vers 1306 Amicie du Breil, fille unique de Guillaume du Breil, chevalier, seigneur du Boisa de-la-Roche, de Vauvert, et de Denise d'Anast, dame du Bois-d'Anast, du Boisbasset, de Launay. Il eut sept enfants : 1° Jean de MONTAUBAN, mort jeune; 2° Renaud II, 3° Guillaume de MONTAUBAN, le fameux écuyer au Combat des Trente, à Mi-Voie, le 27 mars 1350 (vieux style), dont l'habileté et la valeur assura le succès. Il avait été choisi par Beaumanoir le premier de tous parmi les écuyers, comme il est dit dans le poème de la bataille des Trente : Au début de l'action, les Bretons perdirent cinq des leurs, et ils fléchissaient, quand MONTAUBAN assura, par une ruse de guerre, la victoire à ses compagnons. Pensant qu'à cheval il aurait plus facilement raison des soldats de Bembro, il fait semblant de fuir et se dirige vers l'endroit où il avait laissé sa monture. Beaumanoir l'aperçoit qui s'en va et lui reproche ce qu'il prend pour une félonie : « Besoigne, Beaumanoir, s'écrie MONTAUBAN, besoigne, car bien besoigneray! » Aussitôt il enfourche son cheval et se précipite sur les Anglais, dont il détermine ainsi la défaite. Renaud de MONTAUBAN Décèdé à la bataille de Mauron La bataille de Mauron (14 août 1352) est une bataille de la guerre de succession de Bretagne, qui s'inscrit dans la rivalité franco-anglaise de la guerre de Cent Ans. Elle oppose une armée anglo-bretonne du parti de Jean IV de Montfort à une armée franco-bretonne soutenant Charles de Blois, parti auquel appartient Renaud de Montauban. Depuis la mort de Jean de Montfort en 1345 et la capture par les Anglais de Charles de Blois à La Bataille de La Roche-Derrien en 1347, les deux partis campent sur leurs positions. La paix est entrecoupée par quelques escarmouches comme le célèbre Combat des Trente en 1351. En 1352, le roi de France Jean II le Bon relance les hostilités. À la tête d'une armée franco-bretonne le maréchal Guy II de Nesle est chargé de reprendre Ploërmel aux anglo-bretons. À cet effet, Mauron est fortifiée par les Franco-Bretons, en point d'appui avec Josselin, pour préparer leur attaque contre Ploërmel. La place-forte de Mauron contrôle les voies reliant les cités de Dinan, Vannes, Rennes et Carhaix. Cette position stratégique importante est convoitée par le parti de Montfort. Les deux armées se rencontrent au lieu-dit Brambily, actuellement commune de Saint-Léry, près du château de Mauron. Persuadé de sa supériorité, le maréchal De Nesle, propose à Bentley un armistice afin de se rendre ou de retirer ses troupes de l'autre côté de la mer ce que le chef anglais refuse. Il dispose ses troupes en haut d'une colline à 1,5 km des positions françaises les dominant d'une centaine de mètres.En haut de la colline, le capitaine anglais adopte un comportement dicté par la situation de l'ennemi en contrebas en installant ses 800 à 1 000 archers, qui à cette époque sont un élément de supériorité par rapport aux armes des français. Il les place en dominant, adossés à un bois bordé de fourrés, en dessous de la crête de la colline, pour leur permettre de tirer, à l'abri, vers le bas et éviter d'être pris à revers sur les arrières et sur les flancs. Fidèle aux leçons anglaises et à une tactique qui a réussi sur de nombreux champs de bataille, sur la défensive, le soleil dans le dos, faisant combattre à pieds tous ses hommes y compris les chevaliers. Face aux Anglais, le Maréchal d'Offemont dispose en bas de la prairie ses hommes en trois " batailles " qui combattent à pied. La bataille du centre, commandée par le Maréchal d'Offemont est composé des nobles La division de droite est sous les ordres du maréchal Breton Jean III de Beaumanoir secondé par les vainqueur du combat des Trente (Even Charruel, Guillaume de la Marche, de Montauban, Robin de Raguenel, Jean de Tinteniac et Maurice de Tréséguidy) La gauche du dispositif est constituée par un corps de cavalerie de 140 hommes sous les ordres de Roch d'Hangest. Les archers anglo-bretons laissent les Franco-Bretons attaquer, ils se replient et s'abritent pour tirer des milliers de flèches qui font des ravages dans les troupes françaises qui montent à découvert, à l'assaut de la colline. L'aile droite française commandée par Jean III de Beaumanoir, recule puis se débande devant le déluge de flèches. Le centre anglo-breton peut alors descendre la colline en attaquant. Les fantassins anglais se font aider par les archers de l'aile gauche qui n'ont plus personne en face, l'aile droite française ayant été décimée. La bataille fait rage. Les hommes se battent au corps à corps, la mêlée est si confuse et si rude qu'elle rend, à un certain moment, inefficace l'intervention des archers anglais qui se battent en fantassin. Toutefois l'aile gauche franco-bretonne des cavaliers Roch d'Hangest suppléée par Renaud de Trie seigneur de Mareuil, finit par renverser l'aile droite anglaise en tuant plus de 600 archers. Le combat se recentre, chaque troupe ayant perdu une aile. Bentley, malgré de graves blessures, et malgré la perte de ses 600 archers gallois, continue à organiser le combat, il finit par repousser, en fin de journée, ses adversaires Les chevaliers français se battent jusqu'à épuisement. Beaucoup d'entre eux titulaires de l'Ordre de l'Étoile crée le 16 novembre 1351 par le nouveau Roi de France Jean II Le Bon mourront fidèle à leur serment de ne jamais reculer. En fin d'après-midi, la bataille de Mauron se transforme en une cuisante défaite pour les troupes franco-bretonnes du Maréchal Guy de Nesle d'Offemont. Ce dernier entouré par l'élite de ses combattants, se bat courageusement mais après un combat désespéré au corps à corps, ce dernier se fait tuer par Tanguy du Chastel, l'un des lieutenants bretons du capitaine anglais. C'est alors la débandade dans le camp franco-breton, un sauve-qui-peut aveugle qui se termine en affreux carnage. Selon les sources entre 50 et 140 chevaliers franco-bretons périrent avec le maréchal Guy II de Nesle et le héros du Combat des Trente Alain de Tinténiac. Il faudra 2 jours pour retrouver le cadavre du Maréchal Guy de Nesle d'Offemont. Comme à la Roche-Derrien et à Crécy puis plus tard à Poitiers, un nombre important de nobles Bretons et Français périssent, victime des archers anglais et gallois et surtout de leur serment de ne jamais reculer. Les lourdes pertes imposent aux deux partis le statu quo. La guerre ouverte ne reprendra que onze ans plus tard et se terminera en 1364 par la Bataille d'Auray